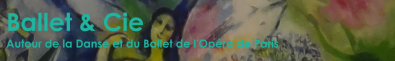Le Théâtre des Champs Elysées, malgré une saison de danse très resserrée, n’en reste pas moins un théâtre d’élection pour la danse, dans la continuité de sa riche histoire avec cet art, et, il faut bien avouer que les spectacles proposés par des artistes issus du classique sont souvent bien plus intéressants que la programmation contemporaine de l’Opéra de Paris.
En témoigne encore, ce mois d’octobre, le passage à Paris de l’English National Ballet avec la Giselle chorégraphiée par Akram Khan, une création de 2016 qui a acquis la réputation de classique instantané. En bonus, cette mini-série de 4 dates marque également les adieux à la scène de la directrice artistique de la troupe, Tamara Rojo, ex-star du Royal Ballet, qui va désormais se consacrer uniquement au management en prenant la tête du San Francisco Ballet.

L’English National Ballet est la deuxième compagnie de danse classique en Grande Bretagne (derrière le Royal Ballet) et peut se targuer de contribuer à la préservation de la tradition, comme nous avions pu le constater en 2016 avec la présentation d’un Corsaire à grand spectacle à Garnier. En parallèle de cette première mission, Tamara Rojo a engagé une réflexion sur l’évolution de l’art du ballet au XXIème siècle, enrichissant le répertoire de la compagnie avec des créations de chorégraphes contemporains majeurs qui sont amenés à hybrider leur propre style avec la technique classique des interprètes pour imaginer des œuvres innovantes. Parmi ces commandes, la Giselle d’Akram Khan, qui réinvente le ballet romantique par excellence, est sans doute la plus représentative de cette ambition artistique.
Akram Khan, chorégraphe britannique d’ascendance bengali, fait partie du Who’s Who de la danse contemporaine. Avec son style mêlant danse contemporaine et le kathak (une danse traditionnelle indienne), il a séduit des artistes en dehors du monde de la danse (Juliette Binoche et Kylie Minogue, entre autres) et a acquis une visibilité internationale par son travail sur la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012.
Quand une œuvre arrive auréolée d’une telle réputation, c’est parfois un peu difficile de ne pas partager l’enthousiasme général, ou, alors, tout simplement, je n’étais pas en forme en ce soir du 12 octobre, car une vilaine fièvre m’a terrassée le lendemain.
Cette relecture de Giselle à l’aune des luttes politiques du XXIème siècle a de quoi faire plonger dans des abîmes de dépression. Les éclairages sont sombres, on peine à distinguer les danseurs, et notamment les solistes, et la composition électronique de Gavin Sutherland qui sample des bribes de la Giselle d’Adolphe Adam est à la limite du supportable pour les oreilles du spectateur, notamment dans les 20 premières minutes.

La campagne romantique de l’original est devenue une sorte de zone de rétention, séparée par un mur du monde des riches (en 2016, on était en pleine polémique autour du mur de Trump), et les paysans se sont transformés en travailleurs migrants qui confectionne à bas coût des vêtements haute couture. Giselle (Tamara Rojo) vit une belle histoire d’amour avec Albrecht (Isaac Hernandez, son partenaire à la ville), un riche qui s’est infiltré dans le camp de migrants. Hilarion, quant à lui, est un peu le caïd du camp, qui trahirait les siens pour quelques signes extérieurs de richesse. Le mur tourne comme une broche de rôtisserie, une corne de brume (on est sans doute près de la mer) ou une alarme de sécurité rappelle le son du cor de chasse, et des visiteurs de marque, déguisés en costumes Grand Siècle, s’aventurent dans le camp. Albrecht qui, de toute façon, était déjà plus ou moins inexistant, rase les murs pour ne pas se faire repérer par sa fiancée. Les mouvements chorégraphiques d’ensemble sont impressionnants, et c’est même très beau à regarder, en faisant abstraction de la pollution sonore, mais on peine à s’attacher aux protagonistes principaux qui sont un peu perdus dans ce dispositif et la scène de la folie m’a paru escamotée. Le livret original que certains esprits blasés pourraient juger naïf et à dépoussiérer s’avère finalement bien plus riche (on n’en finira jamais de s’interroger sur la sincérité des motivations d’Albrecht) que le manichéisme et les bons sentiments de cette version.
Dans le deuxième acte, le fantôme de Giselle retrouve d’autres travailleuses mortes sous les injustices des riches qui hantent une usine désaffectée, commandées par Myrtha. Tim Yip, le concepteur visuel du ballet qui a collaboré sur de nombreuses productions hong-kongaises et sur Tigre et Dragon de Ang Lee, nous emmène quelque part du côté du wu xia pan (film de sabre chinois). Si l’on retrouve bien un corps de ballet des créatures surnaturelles sur pointes, l’émotion me semble complétement absente. Le deuxième acte de la Giselle de Jean Coralli et Jules Perrot, c’est l’alchimie parfaite entre le mouvement et les émotions, la beauté de la chorégraphie fait monter les larmes, avant que l’on ne soit submergé par la poésie de cette histoire d’amour, de pardon et de rédemption. La chorégraphie est beaucoup moins originale dans cette deuxième partie avec des pas de deux néo-classiques génériques, desquels la spiritualité semble complètement absente. A aucun moment, Tamara Rojo et Isaac Hernandez n’ont un matériel qui leur permette d’exister, de devenir autre chose que des esquisses.
En amenant sa Giselle sur le terrain de la lutte des classes, Akram Khan dénature l’essence profonde de l’œuvre et son pouvoir universel. On n’a pas besoin de lire un livret pour se laisser submerger par la vraie Giselle.
Mots Clés : Akram Khan,English National Ballet,Giselle,Isaac Hernandez,Tamara Rojo,Théâtre des Champs Elysées