Une nouvelle saison débute à l’Opéra de Paris avec un soirée contemporaine, mais pas trop, réunissant William Forsythe, une valeur sûre des programmes de reprise, et un petit nouveau à l’Opéra, le Suédois Johan Inger. Cette programmation porte sans doute la patte de José Martinez. En effet, depuis le départ précipité de Benjamin Millepied, William Forsythe qui était alors chorégraphe associé à l’Opéra avait pris ses distances avec la troupe. Il venait pourtant de lui offrir Blake Works I, première page d’une nouvelle série de ballets inspirée par la pop music, qui connaissent depuis un succès retentissant sur la scène internationale. José Martinez a donc réussi à retisser le lien avec le maître américain qui revient pour une création Rearray qui précède la reprise de Blake Works I. Par ailleurs, en faisant entrer au répertoire Impasse, une pièce de Johan Inger auquel il avait commandé une version de Carmen pour la Compañia Nacional de Danza de Espana, José Martinez affirme son attachement pour la danse contemporaine narrative.

Rearray n’est pas à proprement parler un nouveau ballet. William Forsythe avait créé cette pièce pour deux à Londres en 2011 pour un spectacle de Sylvie Guillem qui réunissait la transfuge de l’Opéra de Paris à Nicolas Le Riche. Pour cette entrée au répertoire officielle, Forsythe transpose l’œuvre pour un trio, Roxane Stojanov, Takeru Coste et Loup Marcault-Derouard. Cette pièce n’est narrative au sens strict, mais l’on peut imaginer que le chorégraphe capture des instantanés de la vie de trois danseurs solistes en studio confrontés à une chorégraphie dans le plus pure style de William Forsythe, tantôt en silence, tantôt sur une musique expérimentale quelque peu anxiogène de David Morrow . Il y a la perfectionniste de la technique classique, Roxane Stojanov, qui s’agace de l’approche plus cool des deux protagonistes masculins. On s’amuse de la similitude entre les personnages et leurs interprètes, avec Roxane Stojanov qui s’est donnée à fond pour progresser dans la hiérarchie de la compagnie, et Takeru Coste et Loup Marcault-Derouard, toujours quadrilles mais piliers de la création contemporaine. Peu à peu, un glissement s’opère, la ballerine s’adoucit et son travail du haut du corps se modernise, les artistes parviennent véritablement à dialoguer. C’est une entrée un peu abrupte dans la soirée, mais c’est suffisamment court pour s’arrêter avant que le spectateur ne s’ennuie et c’est parfaitement cohérent avec l’œuvre qui suit.

Si Rearray nous offre une vision minimaliste et sans phare des danseurs face à leur art, Blake Works I offre quant à lui une vision hyper glamour, à travers les lunettes d’une adolescente accro aux fictions young adult, d’une compagnie de danse classique au XXIème siècle. Ce n’est pas un hasard, si c’est la troisième fois que Blake Works I inaugure la saison: c’est en quelque sorte la version pop du défilé du ballet revisité par William Forsythe. La musique de James Blake a décidément pris un petit coup de vieux depuis 2016, mais cette reprise bénéficie d’une distribution qui s’est régénérée avec la mise en avant de nouveaux talents dans la compagnie. Bleuenn Battistoni n’est peut être pas dans sa zone de confort, mais cela introduit un décalage presque ironique entre l’image que le spectateur a d’elle, celle de la ballerine romantique idéale, et sa représentation dans la pièce, une sorte de reine des pom-pom girls. Inès McIntosh est exceptionnelle à regarder danser, c’est la personnalité qui ressort le plus chez les filles, et le duo entre la ballerine de poche et le placide et princier Florent Melac (qui reprend le rôle créé par François Alu en conservant sa personnalité propre) est très intéressant dans son contraste. Enzo Saugar impose une présence charismatique dans son trio avec Silvia Saint-Martin et Naïs Duboscq. Enfin, l’avant-dernier mouvement Two Men Down, entièrement dévolu aux hommes et magnifiquement introduit par le solo de Paul Marque, reste toujours aussi efficace. Mentions spéciales à Hugo Vigliotti, tout en explosivité, et, à nouveau, à Enzo Saugar.



J’aime tout ce que j’ai vu de Johan Inger jusqu’à présent et Impasse ne fait pas exception. C’est sans doute une bonne idée d’avoir préféré une œuvre existante pour cette première rencontre du chorégraphe avec les danseurs de l’Opéra. Impasse a vu le jour en pleine pandémie avec la compagnie junior du Nederlands Dans Theater (le NDT 2) et s’inspire ouvertement de l’actualité du moment en y ajoutant un soupçon de poésie et de douceur, avec une mise en musiques réconfortante (Ibrahim Maalouf, Amos Ben-Tal). Sur le fond de la scène, un cabane décorée de lampions figure une stuga, cette cabane en bois typique de la campagne suédoise. On découvre ses trois occupants (Marion Gautier de Charnacé, Yvon Demol et Julien Guillemard): on pressent que Marion et Yvon forme la cellule initiale du trio, et que Julien est l’ami-amant qui s’incruste. La quiétude de ce coin de campagne est troublée par l’arrivée d’une horde de citadins (tout de noir vêtus, on les imagine travaillant dans des bureaux), d’où se détachent les personnalités de Caroline Osmont, Alexandre Boccara, Letizia Galloni et Max Darlington. Si ce changement est d’abord bienvenue pour notre trio, les infrastructures ne sont pas forcément adaptées à cet afflux soudain de population, une silhouette de stuga plus petite installée devant la précédente signifie cet état de fait. Les citadins se sont installés au vert et ils ont profité de ce retour à la nature revigorant, mais ils commencent à ressentir le manque des divertissements proposés par la ville. Une deuxième vague migratoire (des artistes, des personnages plus exubérants) vient s’installer : c’est une fête permanente qui en vient à en faire oublier à nos héros qui ils sont vraiment, la stuga se miniaturise et un rideau noir descend lentement sur l’avant-scène. Ouf, ils ont le temps de se faufiler en dessous et de préserver leur idéal de vie. Johan Inger trouve le juste équilibre entre la narration et la chorégraphie : il ne s’agit pas de Danz Theater mais bien d’un petit ballet qui peut évoquer Mats Ek ou même Roland Petit. Johan Inger montre également qu’avec une scénographie assez simple, on peut raconter une très belle histoire et faire ressentir des émotions, en utilisant la force de la danse. On espère que ce coup d’essai réussi augure d’une prochaine collaboration du Suédois avec l’Opéra.
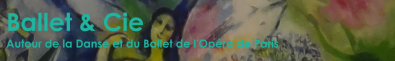
0 commentaires