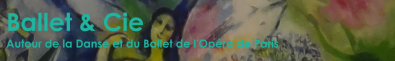La Bayadère a une résonnance particulière pour la spectatrice parfois compulsive que je suis. Il marque mon entrée en balletomanie, cette curieuse lubie de vouloir voir toutes les distributions possibles d’un même spectacle, et la découverte d’un danseur étoile, Stéphane Bullion, que je trouvais un merveilleux Solor et dont j’ai ensuite guetté les spectacles avec assiduité, pour mon plus grand bonheur. Je ne sais d’ailleurs plus vraiment si cette soirée était mémorable du point de vue de la danse pure, mais j’avais été envoûtée par ce ballet romantique, transposé dans une Inde fantasmée. C’est donc avec l’espoir secret d’assister à LA représentation, celle qui vous laisse pantois, que j’ai pris le chemin de l’Opéra Bastille en ce 9 avril.

La dernière reprise du testament chorégraphique de Rudolf Noureev, d’après Marius Petipa, date déjà de la saison 2015-2016 et de la réflexion polémique de Benjamin Millepied comparant le corps de ballet, les fameuses Ombres du dernier acte, à du papier peint. Initialement prévue pour les fêtes de 2020, la Bayadère ne sera finalement donnée qu’une fois devant une salle vide pour une captation diffusée en streaming, marquée par une distribution tournante d’un acte à l’autre et par la nomination d’étoile de Paul Marque, titulaire du petit rôle virtuose de l’Idole Dorée. Cette reprise rapide est donc un bon moyen de capitaliser sur le lourd travail effectué par la troupe et de remplir les caisses avec un spectacle qui fonctionne bien au box-office. On est néanmoins surpris des distributions plutôt inexpérimentées, en particulier pour le rôle de Solor, un petit peu comme si le fil de la transmission s’étirait peu à peu jusqu’au point de rupture sur le répertoire classique de l’Opéra. Non, Solor n’est pas qu’un guerrier bondissant qui enchaîne les grands sauts, il y a aussi une interprétation qui arrive à maturité au fil des reprises. Quel meilleur témoignage de cela qu’un Karl Paquette qui a continué inlassablement à danser Noureev et transcendait les limites physiques de sa fin de carrière par son charisme et sa science du partenariat, nous offrant encore de mémorables soirées.
On espère que la nouvelle génération qui aborde ce classique aujourd’hui aura l’opportunité de le danser plus qu’une dizaine de fois et de le transmettre sur la durée. La distribution de ce 9 avril faisait la part belle aux fers de lance de cette génération : Paul Marque en Solor, Sae Eun Park en Nikiya, la danseuse sacrée, Valentine Colasante en Gamzatti, sa noble rivale.

Pas besoin d’une période d’acclimatation, dès le lever du rideau, la magie opère, avec l’entrée majestueuse de Solor. Paul Marque a désormais une grande autorité sur scène. D’aucun pourrait identifier Solor à une version « indienne » du personnage d’Albrecht dans Giselle. Paul Marque apparaît a contrario comme un homme d’une grande droiture, sincèrement épris de la danseuse sacrée. Moins extraverti et charismatique qu’Hugo Marchand dans le même rôle, dont le Solor éprouvait une passion plus charnelle pour Nikiya, il est plein de révérence pour la jeune femme, meurtrie par les avances non désirées du Grand Brahman (Florimond Lorieux). La première variation de Sae Eun Park est très belle et applaudie à juste titre. Le pas de deux avec Solor du premier acte donne un peu le la pour le reste de la représentation : ce ne sont pas des retrouvailles enflammées, mais une tendre parade d’amour. Francesco Mura, en fakir complice des amoureux, éblouit par sa détente et son dynamisme : il sera intéressant de découvrir son Solor dans quelques jours au côté de Myriam Ould-Braham, peut-être la plus belle des Nikiya de l’Opéra.
Pour le deuxième tableau, il est vraiment appréciable d’être assez près de la scène pour pleinement comprendre la pantomime très présente, avec les intrigues au Palais du Rajah et l’apparition de Valentine Colasante qui campe une Gamzatti imbue de son rang et décidée coûte que coûte à conquérir le cœur du beau guerrier choisi par son père. Paul Marque semble encore un peu timide dans l’expression de ses motivations : obéissance du militaire aux ordres de son supérieur ou éblouissement face à l’éclat de Gamzatti, on n’arrive pas trop à trancher. De même, on a vu des confrontations entre Gamzatti et Nikiya plus acharnées : Valentine Colasante ne cesse jamais de brandir l’étendard de sa naissance supérieure et de rabaisser sa rivale, tandis que Sae Eun Park garde une posture pleine d’humilité, toute de dignité bafouée, avant l’explosion qui la voie s’emparer du poignard et tenter d’attaquer Gamzatti. Cela ne peut que mal se finir, se dit-on quand le rideau se baisse.

L’originalité du deuxième acte est qu’il reprend les codes du pas de deux du mariage (que l’on retrouve dans d’autres grands ballets de Marius Petipa comme La Belle au Bois Dormant ou Don Quichotte) avec la célébration des fiançailles de Gamzatti et Solor (les variations des solistes, l’adage, les divertissements), tout en y intégrant des péripéties dramatiques avec la danse de Nikiya et son assassinat. Paul Marque est totalement dans son élément dans ce deuxième acte. Il livre une variation d’anthologie, il vole sur le plancher, et, à quelques mètres de la scène seulement, les réceptions sont silencieuses. Valentine Colasante est impériale dans sa série de fouettés, mettant la salle en ébullition. On sent Solor gagné par l’ivresse de ce mariage si brillant et par la séduction exubérante de Gamzatti, le piège doré se referme peu à peu sur lui. Le petit sourire satisfait de Gamzatti quand elle invite Solor à s’assoir auprès d’elle pour ne pas manquer la danse de Nikiya est éloquent. Le travail des bras et du haut de corps de Sae Eun Park, dans cette variation, est remarquable, et elle parvient à transmettre une grande émotion.

Les trois solistes et leurs interactions ont un peu tendance à éclipser l’excellente tenue de l’ensemble du corps de ballet, avec l’addition sympathique et non masquée des élèves de l’Ecole de Danse. Marc Moreau surprend en idole dorée. Je ne l’imaginais pas forcément dans ce numéro de pure virtuosité, dansé tout en précision, avec des tempi qui m’ont semblé excessivement lents. On retiendra également l’espiègle Manou de Silvia Saint-Martin et la trépidante danse indienne emmenée par Aubane Philbert et Sébastien Bertaud.

Epilogue fantastique et poétique, le troisième acte au Royaume des Ombres est un ballet abstrait à part entière. Parfois, la performance des solistes prend le pas sur celle du corps de ballet dans cet acte, ou l’on reste sur la magie de la Descente des Ombres. Ce soir, l’équilibre était parfait. Silvia Saint-Martin se joue joliment de la variation de la Deuxième Ombre, sans doute plus payante que celles des deux autres Ombres d’Héloïse Bourdon et Roxane Stojanov qui me sont apparues un peu raides. Sae Eun Park et Paul Marque sont quant à eux la reine et le roi de cet univers éthéré, avec une danse d’une beauté, d’une vitesse et d’une puissance époustouflantes, qualités dont la conjonction n’est pas si fréquente sur la scène parisienne.