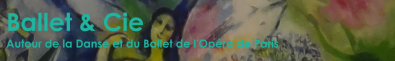Lors de la dernière reprise de la Bayadère, Paris se relevait à peine des attentats de novembre 2015. Il y avait comme un parfum de peur sur la ville, on regardait d’un air soupçonneux son voisin dans la rame de métro et aller au spectacle passait pour un acte de résistance face au terrorisme, une manière de perpétuer l’art de vivre à la française.
En décembre 2020, en pleine pandémie, la peur est toujours de mise, on évite au maximum tout contact humain pour ne pas être contaminé et le danger ne vient plus seulement de l’Autre, mais il est potentiellement dormant à l’intérieur du foyer. Malheureusement, aller au spectacle n’est plus une option : le virus a donc réussi, là où le terrorisme avait échoué.
En 2015, une belle série de Bayadère m’avait redonné le moral et la confiance dans le fait que la vie pouvait reprendre comme avant. La Bayadère version 2020 s’est déroulée dans un grand vaisseau de Bastille vide de tout public, sans applaudissements, devant les caméras de la toute nouvelle plateforme de streaming de l’Opéra, avec les figurants et les danseurs de l’Ecole de Danse portant des masques : un autre monde, complétement terrifiant, d’une froideur clinique, et dans lequel, l’on se demande, comment l’art pourra reprendre sa place. Qu’aurait pensé Rudolf Noureev de voir danser dans ses conditions son ultime leg à la compagnie, cette recréation du ballet de Marius Petipa au travers de laquelle, au crépuscule de sa vie, Noureev ressuscite ses jeunes années au Kirov ?

A circonstances exceptionnelles, dispositif exceptionnel : pour cette captation ainsi que pour la première du 15 décembre finalement annulée, l’Opéra avait imaginé une distribution avec des solistes différents à chaque acte, une manière plutôt habile de donner du temps de danse à un maximum d’étoiles en dépit d’un nombre de représentations qui se réduit comme peau de chagrin. Par ailleurs, la distribution des seconds rôles faisait la part belle aux premiers danseurs.

Si sur le papier, les distributions alternées me semblaient une excellente idée, dans la pratique, le changement d’interprètes amoindrit l’impact dramatique du ballet, notamment dans les deux premiers actes où l’on perd la force de l’affrontement entre Nikiya, la danseuse du temple, et Gamzatti, la princesse, pour l’amour du guerrier Solor.
Au premier acte, la danseuse sacrée de Dorothée Gilbert mérite bien d’être sacralisée et éclipse le reste du plateau quand elle est sur scène. Chaque mouvement, chaque arabesque sont marqués du sceau de la perfection. Dans cet acte d’exposition avec de larges séquences de pantomime, les affrontements avec Vincent Chaillet, grand Brahmane concupiscent, ou avec sa rivale Gamzatti (Léonore Baulac très fille à papa odieuse) sont particulièrement lisibles. Néanmoins, l’alchimie avec son amoureux incarné par Germain Louvet est peut-être moins évidente qu’avec son Solor de la précédente reprise, Hugo Marchand. Germain Louvet a d’ailleurs assez peu à danser ici : une entrée majestueuse avec des grands jetés spectaculaires, un pas de deux bien emmené, mais sans supplément de passion, et un peu de figuration au palais du Rajah quand le piège du mariage de prestige avec Gamzatti se referme sur lui. Dans ce premier acte, on notera également le Fakir bondissant de Francesco Mura ainsi que le toujours sublime Audric Bezard, partenaire parfait de Nikiya dans un de mes passages préférés du ballet, le pas de deux de l’Esclave.

Le second acte, celui de la virtuosité pure avec les fêtes de fiançailles de Gamzatti et Solor, est normalement sous le signe des applaudissements et de la joie de danser. Il est un peu plombé par l’absence de public : que c’est triste de voir la brillante idole dorée de Paul Marque, la pétillante Manou de Marine Ganio entourée des petites danseuses de l’Ecole ou les Indiens Celia Drouy et Axel Magliano emmenant tambour battant la danse du même nom s’incliner dans le silence le plus total. Le couple Gamzatti – Solor, à présent interprétés par Valentine Colasante et Hugo Marchand, fait de son mieux pour combler ce vide. Plus je vois Valentine Colasante sur scène, plus je l’apprécie. Avant qu’elle soit étoile, j’avais l’image d’une technicienne solide, plus athlétique que le profil type de la danseuse de l’Opéra, très à l’aise dans du Balanchine quand il faut danser vite. Je trouve à présent qu’elle projette sa joie de danser de façon assez incroyable, et c’est la seule, dans cette soirée, dont on a eu l’impression qu’elle était face à une salle comble applaudissant ses fouettés à tout rompre. Sa Gamzatti semble assez différente de celle campée par Léonore Baulac au premier acte: Solor n’est pas un dû, un cadeau de plus offert par son père, mais elle essaie réellement de séduire cet homme que les conventions sociales ont désigné pour être son mari. On remarque comment elle cherche son regard, alors que lui cherche à l’éviter, avant de se laisser gagner par des sentiments plus doux. Gamzatti est après tout un trophée de choix pour l’ambitieux Solor. Le confinement n’a pas atténué la présence scénique d’Hugo Marchand, même s’il faut avouer que c’est un peu moins impressionnant derrière un petit écran qu’en vrai. Amandine Albisson est, quant à elle, une Nikiya moins vestale et plus « humaine » que celle de Dorothée Gilbert. Elle retrouve la scène de la mort de Nikiya dans laquelle elle avait brillé au concours de promotion : on regrette vraiment de ne pas voir plus de son interprétation.

Le troisième acte est celui qui correspond le mieux aux qualités du dernier couple de la soirée. Myriam Ould-Braham est LA ballerine romantique de l’Opéra et son partenariat avec Mathias Heymann est toujours une évidence. Quant à Mathias Heymann, le voir danser Noureev est un plaisir sans cesse renouvelé : les années ne semblent pas avoir de prise sur sa technique et il est de plus en plus émouvant. Généralement, c’est la Descente des Ombres (un peu sombre sur l’écran) qui provoque une première montée de larmes pour le spectateur, ici, c’est la variation lente d’entrée de Solor. C’est sans doute le duo que j’aurais choisi de voir sur une soirée entière même s’il m’a manqué cette sensation de communion silencieuse de la salle devant la beauté de cet acte blanc.

Cette première sur la nouvelle plateforme s’est avérée un beau succès d’audience (environ 10000 connections en direct). On espère que le catalogue va s’étoffer rapidement. Par ailleurs, l’Opéra met en ligne sur son compte Instagram un calendrier de l’Avent avec les répétitions de la Bayadère. C’est également une belle opportunité de découvrir le ballet, avec même davantage d’émotion que lors de cette captation : la caméra au plus près des danseurs apporte cette chaleur qui manque tant à la représentation sur scène.

Il ne sera pas dit que la soirée serait privée de toute émotion et d’applaudissements. Paul Marque a été sacré danseur étoile à l’issue de la représentation : le sourire du jeune homme mêlé de larmes et sa surprise, les félicitations de ses collègues nous ont réchauffé le cœur l’espace d’un instant. Certes, l’idole dorée n’est qu’un petit rôle, mais, depuis 2 saisons, Paul Marque a prouvé qu’il était une valeur sûre de la maison. C’est symbolique qu’il ait été nommé en présence de Mathias Heymann avec laquelle il partage la facilité, l’élégance et la musicalité, mais aussi une grande humilité dans l’attitude.
Mots Clés : Amandine Albisson,Audric Bezard,Axel Magliano,Célia Drouy,Dorothée Gilbert,Francesco Mura,Germain Louvet,Hugo Marchand,La Bayadère,Léonore Baulac,Marine Ganio,Mathias Heymann,Myriam Ould-Braham,Noureev,Paul Marque,Valentine Colasante,Vincent Chaillet