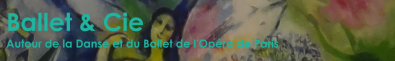Dans la continuité d’une saison qui fait la part belle aux ballets narratifs, le programme mixte Cullberg / De Mille réunit les destins tragiques de deux jeunes femmes dans un environnement de culture protestante à la fin du XIXème siècle. Pour brosser ces portraits de femmes, les deux chorégraphes femmes, l’américaine Agnes de Mille et la suédoise Brigitte Cullberg, s’attachent à démonter l’implacable mécanique sociale qui détruit psychiquement et littéralement leurs héroïnes.
Malgré ses points d’accroche, leur proximité dans le temps (l’après-guerre) et un certain naturalisme, il s’agit d’œuvres très différentes dans leur dynamique et leur esthétique.
Fall River Legend est basée sur une histoire vraie, celle de Lizzie Borden, accusée en 1892 du meurtre de son père et de sa belle-mère à Fall River, une petite ville du Massachussets. Elle a été acquittée par le jury, un jury d’hommes pour lesquels il semblait impensable qu’une jeune femme pareille à leurs propres filles puisse commettre un tel acte. La transposition dansée d’Agnès de Mille prend la liberté de condamner la jeune fille. Entre l’introduction où le jury prononce la sentence et la conclusion où elle est pendue, nous sommes les spectateurs de la «tempête sous le crâne» de Lizzie Borden (Nolwenn Daniel). Elle revit en flashback son enfance heureuse jusqu’à la mort de sa mère (Séverine Westermann), marquée par la complicité avec son père (Bruno Bouché) et une éducation relativement libre, puis l’arrivée d’une belle-mère (Marie-Solène Boulet), qui va accaparer le père tout en enfermant la fille dans sa condition de simple femme, enfermement symbolisé par les lignes géométriques et austères de l’unique décor, tour à tour gibet, maison ou chapelle.
Loin de contribuer à mieux l’intégrer à la jeunesse de Fall River, cette « normalisation » ne fait qu’accentuer le fossé entre Lizzie et les autres : une seule lueur d’espoir, l’amour du pasteur (Sébastien Bertaud), qui lui donne un aperçu des plaisirs simples de son âge, mais aussi la perspective d’une vie indépendante, sur un pied d’égalité avec son mari, espoir brisé par la marâtre qui calomnie sa belle-fille auprès de son prétendant, précipitant ainsi l’issue fatale.
Lors de la présentation du ballet, le répétiteur Paul Sutherland nous expliquait qu’il ne s’agissait pas d’un ballet démonstratif, que la danseuse devait danser comme si le rideau était fermé, et que c’était comme si les spectateurs soulevaient le rideau pour capturer la vie quotidienne et l’intimité des personnages. C’est peut-être pour cela que je ne suis pas parvenue à rentrer dans l’histoire, et que les motivations des différents personnages sont restées peu compréhensibles pour moi : je n’ai pas réussi à soulever le rideau et je n’avais pas franchement envie de le faire. C’est lorsque le spectacle s’éloigne de son côté «reconstitution théâtrale d’une cause célèbre» et s’aventure à explorer les rêves de son héroïne qu’on se laisse embarquer et que les danseurs semblent enfin être dans un élément familier: le pas de deux où Lizzie imagine retrouver sa mère dans l’au-delà, ou encore ses interactions avec son moi enfant (Alice Catonnet), génèrent une émotion palpable.
Dommage également pour les danseurs, car ce genre de pièce, même s’ils ont des dons d’acteurs « muets » exceptionnels, ne permet pas d’apprécier leur travail si l’on n’est pas très proche de la scène.
Le deuxième ballet, Mlle Julie, bien qu’adaptation de la pièce de Strindberg, semble paradoxalement beaucoup plus dynamique que l’histoire vraie de Lizzie Borden. Les dessins du décor sont jetés sur la toile avec vigueur, on n’est pas à la recherche de l’économie et du naturel dans le geste, mais la danse est partout sur scène : une danse au langage très classique pour les représentants des classes supérieurs, une danse plus fruste pour les paysans et les serviteurs que la chorégraphe fait travailler sur la gravité de leur corps.
Eleonora Abbagnato est Mlle Julie, une jeune femme qui, elle aussi, a reçu une éducation qui l’amène à se considérer comme l’égale des hommes. La confrontation avec son fiancé (Yann Saïz) où elle s’essaie à vouloir lui dicter sa loi, se solde pour elle par une cruelle déconvenue : voilà le pantin qui se rebelle et rompt les fiancailles. La pantomime est très lisible, Eleonora Abbagnato joue avec brio la femme capricieuse puis l’enfant boudeuse. Faute de pouvoir asservir un homme de sa classe, elle va jeter son dévolu sur un serviteur, Jean, le valet de son père, qui règne sur le petit monde des « gens du bas » et que son intellect place au dessus de son milieu. Stéphane Bullion apporte à ce personnage à la fois une séduction très terrienne (il attire telle un aimant toutes les femmes lors de la fête de la Saint-Jean) et également un détachement et une puissance mystérieuse qui vont lui permettre d’inverser le rapport de maître à serviteur.
De prime abord peu convaincue par l’association des deux étoiles, j’ai trouvé leur affrontement physique et psychologique passionnant à suivre. Quelle belle intensité dans la passion d’Eleonora Abbagnato, aussitôt suivie par la désillusion : elle n’était qu’un instrument d’élévation sociale pour le valet, et elle a perdu le droit à la considération de ses propres servantes. Dans une ultime transgression, elle est même prête à voler l’argent de son propre père : dans une scène assez saisissante, les spectres de ses ancêtres sortent des portraits de famille et accablent la jeune femme, une autre «tempête sous un crâne» qui la conduit aux portes de la folie et à un «suicide» que le valet veule et lâche ne fait rien pour arrêter.
Mlle Julie est donc une entrée réussie au répertoire de l’Opéra, une œuvre qui exploite idéalement les qualités de ses interprètes et qui donne envie d’être revue pour voir la signification que sauront lui donner d’autres couples.
Mots Clés : Cullberg,De Mille,Eleonora Abbagnato,Fall River Legend,Mlle Julie,Nolwenn Daniel,Sébastien Bertaud,Stéphane Bullion