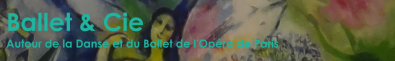Je cherche encore le fil conducteur de la première programmation de la saison, associant une création du plasticien Hiroshi Sugimoto et la déjà troisième reprise de la dernière création de William Forsythe pour l’Opéra de Paris, Blake Works I. Ah oui ! le chorégraphe de la première pièce, Alessio Silvestrin, qui n’a même pas le droit à son nom sur l’affiche, est passé par la Forsythe Company. Une habitude récurrente de la programmation danse de l’Opéra ces derniers temps, c’est en tout cas la courte durée des soirées, avec 1 tiers d’entracte, et les musiques enregistrées, le tout à des tarifs pas du tout bradés.

Pour sa création, Hiroshi Sugimoto s’appuie sur une pièce de théâtre de 1916 du poète irlandais William Butler Yeats, At the Hawk’s Well, inspirée par les mythes celtes et empruntant des éléments au théâtre japonais nô. Un petit coup d’œil à la notice Wikipedia de l’œuvre permet de repérer qui est qui sur la scène occupée en son centre par une sorte de ponton en bois conduisant à la fosse d’orchestre, figurant le puits du titre : il y a un vieil homme (Alessio Carbone) qui attend près du puits depuis une éternité, un jeune homme (Hugo Marchand) en quête de cette eau qu’on dit porteuse d’immortalité et une femme-faucon (Ludmila Pagliero), créature surnaturelle, gardienne du puits.
Sur le papier, il y a une matière propice à la chorégraphie : on pense à l’Après-Midi d’un Faune, au travail de Martha Graham sur les mythes grecs ou au Kaguyahime de Jiri Kylian. Malheureusement, de chorégraphie, il n’y en a pas vraiment ici, c’est aussi vite vu, aussi vite oublié, avec des mouvements sans aucun lien avec la musique électronique passe-partout de Ryoji Ikeda (pourquoi pas un ensemble de musique traditionnelle japonaise sur scène ?). Les 3 solistes n’ont rien de consistant à danser, et les ensembles de l’armée mixte, affublée de costumes d’amazones, de la femme-faucon, semblent répéter en boucle la même séquence.
Côté scénographie, étant donné le pedigree d’Hiroshi Sugimoto et l’avertissement sur la fiche de distribution (des effets stroboscopiques potentiellement dangereux pour les personnes sujettes à des troubles épileptiques), on s’attend au moins à un choc visuel et esthétique, mais c’est plutôt des costumes de Rick Owens entre culture manga et vide-grenier des costumes d’une série fantasy des années 90 que le choc (pas forcément positif) vient. C’est déjà kitsch et démodé, même si le physique d’Apollon d’Hugo Marchand aide à faire passer le ridicule. L’apparition dans le final d’un acteur nô donne une idée de ce qu’aurait pu être la pièce, si elle avait eu un vrai fil directeur. On ne sait pas si l’on doit remercier Aurélie Dupont pour cette addition dispensable au répertoire de la compagnie, ou plutôt les institutions culturelles françaises, à la solde des spéculateurs de l’art contemporain pour faire la promotion de leurs artistes en parasitant les lieux emblématiques de notre patrimoine.

Après un entracte de 30 minutes, où l’on peut s’amuser en observant les hologrammes générés dans les loges par l’installation de Dominique Gonzalez-Foerster, Marienbad Electrique, on retrouve enfin de vraie danse avec William Forsythe. Son Blake Works I est devenue la tube de la maison depuis sa création en 2016. C’est déjà la troisième reprise et la pièce était dans les valises de la dernière tournée en Chine. Mais, comme tous les tubes, il encourt le risque de devenir une scie. L’énergie de la distribution originale semble s’être émoussée (l’absence de Ludmila Pagliero, de Germain Louvet et de François Alu notamment se fait sentir), et la musique de James Blake a 3 ans maintenant et apparaît datée. Seul moment de jubilation dans la soirée : l’avant-dernier ensemble Two Men Down entièrement dévolu aux hommes avec le solo introductif de Paul Marque, tout simplement magique.
Mots Clés : Alessio Carbone,Blake Works I,Hiroshi Sugimoto,Hugo Marchand,Ludmila Pagliero,Paul Marque,William Forsythe