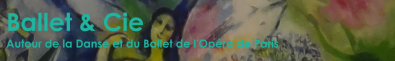Pour débuter 2020, Giselle, le classique des classiques, revient sur la scène de l’Opéra Garnier pour une très courte série, avant de partir à la fin du mois de février dans les valises de la tournée des danseurs parisiens au Japon.
Cela faisait très longtemps que je n’avais pas été aussi impatiente avant d’assister à une représentation à l’Opéra. Il faut reconnaître à la longue grève qui nous a privés des réjouissances de fin d’année le mérite d’avoir suscité une sensation de manque et de donner un caractère exceptionnel au simple fait d’assister à un spectacle. Et ce n’est pas le texte de l’intersyndicale lu avant le levé de rideaux, diversement apprécié par la salle, qui me fera bouder mon plaisir.

Giselle, c’est une œuvre dont je ne me lasse pas. A la première vision, je crois qu’on est surtout marqué par le deuxième acte, la quintessence de l’acte blanc du ballet romantique avec son imagerie fantastico-gothique, et peut-être moins par la première partie avec sa pantomime pas toujours compréhensible pour le néophyte et sa démonstration de la technique et du style français. Mais, au fil des visions, on est frappé par l’incroyable richesse de cette œuvre, malgré la simplicité de sa dramaturgie, et les infinies possibilités qu’elles offrent à ses interprètes en termes de jeu pur, bien au-delà de la simple chorégraphie. C’est pour cela que, contrairement à d’autres œuvres classiques du répertoire, Giselle reste la chasse gardée des étoiles qui continuent à creuser leurs personnages tout au long de leur carrière : la scène de la folie semble ainsi un terrain de jeu inépuisable pour la ballerine, tandis que le danseur pourra incarner un Albrecht sincèrement amoureux ou un coureur de jupons qui découvre la beauté du véritable amour.
Pour ma première matinée, le dimanche 2 février, c’est le couple Dorothée Gilbert et Mathieu Ganio qui tenaient la tête d’affiche, la distribution idéale sur le papier et qui d’ailleurs a eu les honneurs de la diffusion cinéma et web. Dorothée Gilbert est actuellement une des plus belles étoiles internationales, et chacune de ses trop rares apparitions sur la scène parisienne est à marquer d’une pierre blanche. Si on adore la voir distribuer avec Hugo Marchand avec lequel elle forme un duo flamboyant et passionné, c’est avec plaisir qu’on la voit retourner à ses anciennes amours, en l’occurrence Mathieu Ganio, Albrecht avec un A capital de l’Opéra.

Il y a comme de l’électricité dans l’air à l’entrée des deux étoiles, saluées chacune par des applaudissements « à la russe ». Mathieu Ganio campe un jeune noble, que l’on devine bienveillant, en quête des distractions simples que sa vie privilégiée ne peut lui offrir et notamment d’une amourette avec la plus jolie paysanne de la clairière que domine le château familial. Dorothée Gilbert descend de son piédestal de déesse de la danse, et retrouve la fraîcheur de ses jeunes années. Le couple offre une prestation enlevée et pétillante, comme une miniature qui s’anime. Audric Bezard est parfait en amoureux éconduit : il incarne le monde réel avec ses passions, sa violence et aussi son bon sens terre-à-terre qui va faire imploser la bulle imaginaire dans laquelle vivent Giselle et Albrecht.
Le vrai sommet du premier acte, c’est néanmoins une scène de la folie où Dorothée Gilbert est prodigieuse : elle tient à la fois le public et le plateau en haleine, nous faisant entrer dans son monde intérieur et la transition entre la petite paysanne enjouée et la femme passionnée est poignante.

C’est sans doute dans le deuxième acte que les affinités électives entre Dorothée Gilbert et Mathieu Ganio s’expriment le mieux. Dans le monde fantastique des Willis et de leur reine Myrtha (majestueuse et autoritaire Valentine Colasante), c’est Giselle, qui dans une curieuse inversion des rôles supposés, protège Albrecht et le guide vers sa rédemption. Magie du jeu de pointes particulièrement silencieux de la ballerine, lignes magnifiques du prince, beauté des portés aériens : l’acte blanc réussit à nouveau à me transporter dans un autre monde. Au retour dans l’agitation urbaine parisienne, je n’ai qu’une envie retourner dans la forêt embrumée de Giselle.

Ma deuxième matinée, celle du samedi suivant, marquait la prise de rôle d’Hugo Marchand en Albrecht.
Il était aux côtés d’Amandine Albisson, avec laquelle il forme un couple esthétiquement proche de la perfection (je me souviens de leur Diamants en ouverture de la saison 2017) mais qu’on ne sent pas forcément sur la même longueur d’ondes émotionnelle.
Et bien, il semblerait qu’ils se soient trouvés avec Giselle. Elle, avec son jeu assez naturaliste, le tempère alors qu’il a parfois un peu tendance à surjouer, et, lui, avec ses qualités de partenaire, la rassure et l’aide à sortir d’une réserve qui peut passer pour de la froideur.

Avec ces deux-là, le premier acte m’a semblé bien plus prenant qu’avec Dorothée Gilbert et Mathieu Ganio, plus incarné, moins dans une sorte d’épure idéale. La pantomime était extrêmement lisible, et, c’est assez rare pour être signalé, le public a plusieurs fois réagi aux mimiques des deux danseurs, qui nous racontaient un joli roman d’amour et nous ont fait entrer tout de suite dans le ballet. Comme Mathieu Ganio, Hugo Marchand campe un Albrecht amoureux, plus soucieux de son rang et également un peu plus fougueux et physique. Les confrontations avec Audric Bezard, Hilarion des 2 distributions, en deviennent plus dramatiques. Amandine Albisson a fait évoluer sa Giselle depuis 2016, notamment dans la scène de la folie: elle y était moyennement convaincante, c’est maintenant un vrai grand moment. Le spectateur ressent son coeur qui se brise (au sens propre et figuré) sous le poids d’un trop-plein de passion déçue. Certes, du côté de la technique, sa diagonale de ballonnés sur pointes est un peu prudente et ses pieds sont moins rapides que ceux de Dorothée Gilbert ou de Ludmila Pagliero, mais ses tours attitudes et ses équilibres sont remarquables : chaque danseuse a, après tout, les qualités et les défauts de son physique.
Le pas de deux des paysans était un régal (peut-être un des plus jolis que j’ai vus) avec Eléonore Guérineau exceptionnelle et Francesco Mura plus brillant que le dimanche précédent et lors de la captation.

Hannah O’Neill était mon souvenir marquant de la dernière série de Giselle. Sa Myrtha m’avait arraché des larmes, simplement par la beauté de sa danse. Cela n’a pas manqué non plus aujourd’hui. Le silence de son travail de pointes, ses grands sauts, la facilité d’exécution, c’est tout simplement du grand art. Même si Valentine Colasante a très bien dansé le dimanche précédent, sa Myrtha plus « terrienne » m’a moins touchée. Bianca Scudamore se distingue dans le rôle d’une deux Willis (elle n’aura sans doute pas longtemps à attendre pour s’illustrer dans le rôle-titre).
Amandine Albisson déploie une rare douceur pour Albrecht dans ce deuxième acte, et Hugo Marchand est assez bouleversant, qu’il contemple simplement la tombe de Giselle ou qu’il danse avec ses entrechats six que je n’ai pas comptés et qui arrachent presque un cri de douleur.

Hugo Marchand a gagné ses galons de nouveau grand Albrecht de l’Opéra et même de la planète danse tout court. Albrecht rentre dans mon top 3 tout personnel de ses rôles avec son Des Grieux inoubliable avec Dorothée Gilbert et son Solor avec la même. Amandine Albisson, quant à elle, semble avoir trouvé sa voie dans l’interprétation et un partenaire d’élection. Ce n’était pas forcément la distribution que j’avais cochée en premier sur mon agenda, mais j’en suis sortie comblée et émue.