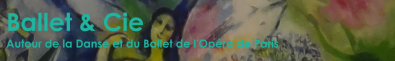En cette période de confinement, le Ballet de Stuttgart offre une programmation en ligne particulièrement intéressante pour l’amateur de danse en quête de nouveauté. Imaginez que l’Opéra de Paris, au lieu de mettre en ligne des captations cinéma, nous ouvre ses archives vidéo et propose des enregistrements inédits (l’unique représentation de Raymonda ou la générale du Parc cette saison par exemple). Certes, dans cette configuration, les mouvements de caméra sont réduits au strict minimum (avec un seul angle de vue) mais le plaisir de la danse est bien là, permettant de découvrir une compagnie à l’ADN résolument néo-classique.

Deux semaines après une Belle au Bois Dormant chorégraphiée par Marcia Haydée, l’une des grandes figures du Ballet de Stuttgart, une production à l’identité bien affirmée et d’une grande élégance, je me suis plongée dans Mayerling, une des œuvres phares du Britannique Kenneth Mac Millan, ballet emblématique du répertoire du Royal Ballet, entrée au répertoire de Stuttgart en mai 2019. Le lien de Kenneth Mac Millan avec Stuttgart remonte aux années 60 lorsque son ami et collègue John Cranko, fondateur de la compagnie moderne, l’invite à chorégraphier quatre ballets. Il est donc assez naturel que le Mac Millan Estate ait accordé les droits de Mayerling au Ballet de Stuttgart. Pour l’occasion, la production originale de Nicholas Georgiadis est remplacée par une version signée de Jürgen Rose, autre légendaire scénographe de ballet (La Dame aux Camélias, Onéguine).
Pour ceux pour lesquels Mayerling évoque un luxueux drame en costumes avec Omar Sharif et Catherine Deneuve, romantisant l’histoire d’amour dramatique, conclue par un double suicide, de l’archiduc Rodolphe et de sa maîtresse Marie Vetsera, ici on serait plutôt du côté des Damnés à la cour de l’empire austro-hongrois déclinant. Ce ballet de près de 2h30 en trois actes est d’un noir d’encre et d’un pessimisme absolu sur la nature humaine, et ce n’est pas la compilation de musiques de Liszt arrangées par John Lanchbery qui va alléger l’atmosphère. Dans la galerie de personnages qui nous est présentée, il est bien difficile de s’attacher à l’un d’entre eux.

Au centre de l’œuvre, omniprésent, l’archiduc Rodolphe est campé par la star de Stuttgart, Friedemann Vogel, qui livre une grande performance d’acteur dans ce qui est sans doute l’un des rôles les plus exigeants du répertoire masculin. Je ne vois guère que Spartacus ou Ivan le Terrible, purs produits du ballet soviétique, pour proposer un défi physique supérieur. La difficulté technique est ici concentrée sur le partenariat avec des pas de deux vertigineux, dopés aux enchaînements et aux portés tarabiscotés, avec pas moins de cinq partenaires. La palette d’émotions et de situations à interpréter ne doit pas laisser non plus le danseur indemne : névrose, perversion, sadisme, addictions, tendances maniaco-dépressives, viol, sentiments incestueux, éternel héritier en quête de sens, tentative de parricide …on peut difficilement charger plus la barque.

Kenneth Mac Millan va assez loin dans ce qu’il est acceptable de voir sur scène, notamment lors du pas de deux de la nuit de noces, qui s’apparente à un viol, entre Rodolphe et la princesse Stéphanie (Diana Ionescu). Rodolphe s’y révèle démoniaque et cruel, alors même, que, quelques minutes auparavant, nous avions éprouvé un début de compassion pour lui, après le pas de deux sur le fil du rasoir avec sa mère, l’impératrice Sissi (Miriam Kacerova), peut-être le seul passage émouvant de cette chorégraphie. Alicia Amatriain livre également une belle composition en Comtesse Larisch. Tantôt vieille maîtresse, entremetteuse de la bonne société, mère de substitution ou amoureuse délaissée, il y a quelque chose de tragique dans ce personnage, qui aurait pu être la planche de salut de l’archiduc. La jeune Marie Vetsera (Elisa Badenes) est présentée, non pas comme une pure jeune fille, mais comme une égale de Rodolphe, une partenaire de jeux sexuels plus que consentante, le catalyseur du drame à venir.

Mayerling est une œuvre dense, avec un découpage cinématographique qui ne l’empêche pas de rester confuse à la première vision: il est assez compliqué de savoir qui est qui de prime abord. Par ailleurs, il y a un côté excessif, voire un peu racoleur (cf. la scène dans la taverne et les pas de deux hyper sexualisés) dans le style Mac Millan, qui peut déranger et qui est un peu daté, des caractéristiques que l’on trouvait aussi dans l’Histoire de Manon, mais qui étaient plus digestes, du fait d’une narration plus lisible et d’une plus grande facilité à s’identifier aux héros. En revisionnant quelques extraits, j’ai davantage pu entrer dans le ballet.
La pandémie fait que nous ne découvrirons pas Mayerling à l’Opéra de Paris cette saison. On imagine que ce ne sera que partie remise (en 2021-2022 ?). Curieusement, après avoir vu le ballet, je ne suis plus si impatiente : sans doute que Stéphane Bullion aurait été un grand Rodolphe mais je me demande si c’est vraiment une œuvre pour l’Opéra, et s’il n’aurait pas mieux valu investir sur la création d’un ballet narratif « neuf », plus en lien avec le patrimoine français, que dans cette entrée au répertoire.
Mots Clés : Friedemann Vogel,Mac Millan,Mayerling,Stuttgart Ballet