Il faut reconnaître que Stéphane Lissner, malgré quelques erreurs de gestion (l’affaire des cloisons, le départ anticipé de Benjamin Millepied), est en passe de réussir un de ses paris, à savoir redonner à l’Opéra de Paris une place de premier plan sur la scène lyrique mondiale. La soirée Iolanta / Casse-Noisette était un des atouts maîtres dans cette stratégie de reconquête avec des ingrédients pour le moins alléchants : réunion exceptionnelle dans l’écrin de l’Opéra Garnier de deux œuvres de Tchaïkovski, l’opéra Iolanta et le ballet Casse-Noisette, créées lors d’une même soirée en 1892 à Saint-Pétersbourg, un seul metteur en scène Dmitri Tcherniakov connu pour ses partis pris audacieux, le brillant Alain Altinoglu à la baguette, une diva à fort potentiel Sonya Yoncheva, des chorégraphes dans le vent et les Etoiles de l’Opéra de Paris.

Sonya Yoncheva
En partant sans idées préconçues sur l’aridité supposée d’un opéra en russe surtitré et sur ce qu’on attend d’une nouvelle version de Casse-Noisette au XXIème siècle, j’avoue avoir passé ma meilleure soirée à Garnier depuis un mémorable Paquita la saison dernière. Pendant plus de 3 heures, j’ai été tenue en haleine par l’ingénieuse mise en scène de Dmitri Tcherniakov qui tisse un lien à la fois concret et spirituel entre les deux œuvres. La représentation de l’opéra Iolanta est le présent d’anniversaire de Marie, l’héroïne de Casse-Noisette, qui fête ses 16 ans dans la grande maison familiale. Un parallèle s’établit entre Iolanta, la princesse aveugle séquestrée pour son bien par son père, qui recouvre la vue et découvre l’amour grâce au preux chevalier Vaudémont, et Marie, amoureuse de l’interprète de Vaudémont, qui vit une voyage onirique et psychologique vers l’âge adulte, un voyage au-delà du miroir où les personnages de l’opéra et de la vraie vie de Marie se confondent dans son esprit troublé.

Le salon d’Iolanta
La mise en scène d’Iolanta est minimaliste : toute l’histoire se déroule entre les quatre murs d’un salon Biedermeier aux dimensions d’une scène réduite. Exercice délicat et qui peut prêter à sourire que de transposer une histoire d’amour courtois dans le cadre d’un mélodrame bourgeois, mais cela convient plutôt bien au caractère intimiste de l’œuvre et cela permet à la beauté du chant de s’épanouir sans que l’attention du spectateur soit polluée par une scénographie trop présente. Parmi les points d’orgue de ce court opéra, on est ému par l’air du père « Seigneur, si j’ai péché, pourquoi faut-il qu’un ange souffre?» et le duo de Iolanta et Vaudémont, hymne à la lumière du jour et à la révélation de l’amour, sur lequel se clôt la première partie de la soirée.

Un spectacle à la maison
La résolution de l’intrigue d’Iolanta prend place après l’entracte, et la scène réduite s’élargit pour céder la place à la salle de réception de la demeure cossue des parents de Marie. Les notes de l’ouverture de Casse-Noisette s’égrènent pendant les saluts de l’opéra. Ce qui va suivre ne relève pas vraiment du ballet, mais d’un maelstrom où se rencontrent théâtre dansé, ensembles de musical, danse de salon, installation avec chorégraphie et pas de deux entre néo-classique et contemporain. Le nouveau livret de Dmitri Tcherniakov reste fidèle dans les grandes lignes à la trame originelle : on retrouve la réception, le cauchemar puis le voyage avec le prince/Vaudémont au pays des rêves où les divertissements sont remplacés par une surprise-partie avec des jouets géants avant le retour à la réalité. On est néanmoins bien loin des sucreries des fêtes de fin d’année. Là où Noureev avait déjà introduit un sous-texte psychanalytique dans sa version, ici l’éveil à la sensualité de la jeune Marie est mis en scène de façon bien plus explicite.
La répartition de la chorégraphie entre les trois artistes commandités par l’Opéra de Paris se fait par ambiance : normalité joyeuse d’une fête d’anniversaire dans les années 50 pour Arthur Pita dans la continuité de la représentation d’Iolanta, famille dysfonctionnelle, cauchemar et univers inquiétant sur fond de sexualité exacerbée pour Edouard Lock, les envolées lyriques et romantiques des passages emblématiques du ballet (Valse des Flocons, Valse des Fleurs, Danse de la Fée Dragée et pas de deux) pour Sidi Larbi Cherkaoui. Ces chorégraphies prises séparément n’ont rien d’exceptionnel, mais elles trouvent leur force en s’inscrivant dans un tout et en servant la vision du metteur en scène. Le travail d’Arthur Pita est somme toute simpliste, mais il a le mérite de présenter les personnages et de nous faire entrer dans l’univers familier de Marie. Edouard Lock est sans doute le chorégraphe qui propose le travail le moins consensuel. On peut être allergique à ses danseuses qui se grattent ou se frottent de façon compulsive et flirtent avec les jouets géants, mais ces images suscitent un sentiment de curiosité – répulsion que je trouve plutôt bien vu dans les passages concernés : là encore, on est dans la tête de Marie. Sidi Larbi Cherkaoui a finalement la partie la plus facile pour amadouer les amateurs de ballet: ces passages sont quasiment les seuls éléments autoporteurs de l’histoire sur des tubes de la danse classique.

Pas de deux de fin du monde
Après la simplicité d’Iolanta, la scénographie, comme en miroir de la partition de Casse-Noisette, prend de l’ampleur et en met plein la vue. On est impressionné par l’’explosion de la maison et le pas de deux dans un univers de gravas, de cendres et de désolation qui suit. Le début de la troisième partie où Marie se retrouve dans une forêt en réalité augmentée (formidables projections vidéos d’Andrey Zelenin), confrontée aux doubles de Vaudémont, est visuellement très réussi et plonge le spectateur dans l’univers mental de la jeune femme.

Marion Barbeau et Sonya Yoncheva
Le spectacle repose évidemment beaucoup sur la présence scénique et la force d’interprétation de la danseuse qui incarne Marie, et Marion Barbeau est extraordinaire dans un rôle qui n’exige pas de prouesses techniques mais un complet lâcher prise et une mise à nue psychologique qui mettent le spectateur par moments dans la peau d’un voyeur. Elle est parfaitement accompagnée par Stéphane Bullion en Vaudémont: d’ailleurs je ne vois pas trop quel autre danseur de l’Opéra pouvait endosser le personnage sans sombrer dans le roman à l’eau de rose. Ils contribuent beaucoup à mettre en valeur les pas de deux de Sidi Larbi Cherkaoui. Alice Renavand troque les pointes contre des talons aiguilles et déjoue le ridicule potentiel de la chorégraphie d’Edouard Lock en mère stricte qui se transforme en initiatrice aux plaisirs interdits dans le rêve de Marie. On retrouve à leurs côtés une distribution réunissant la fine fleur du corps de ballet et notamment des interprètes férus de contemporain (Nicolas Paul, Adrien Couvez, Takeru Coste, Simon Valastro, Charlotte Ranson, Juliette Hilaire).
- Alice Renavand (la Mère de Casse-Noisette) et Elena Zaremba (la gouvernante d’Iolanta)
- Marion Barbeau
- Les deux Vaudémont: Stéphane Bullion et le ténor Arnold Rutkowski
- Marion Barbeau et Stéphane Bullion
Compte tenu des moyens considérables mis en oeuvre pour cette production, la question de savoir s’il s’agit d’une réalisation éphémère se pose forcément. On voit mal la soirée redécoupée en deux: la mise en scène d’Iolanta est trop modeste, et l’introduction de Casse-Noisette tomberait un peu à plat sans l’opéra qui précède et la pauvreté de sa chorégraphie ressortirait cruellement. Les deux oeuvres dans cette production semblent donc condamnées à être reprises ensemble ou jamais.
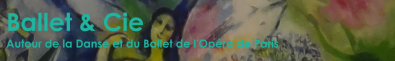




0 commentaires