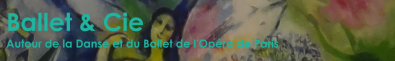Dernier spectacle de la saison parisienne pour moi, Barbe-Bleue chorégraphié par Pina Bausch ne laisse pas le spectateur indemne. Alerte aux parents qui, voyant le titre du conte de Charles Perrault associé à « ballet » sur le site de l’Opéra, croient emmener leurs bambins voir un innocent divertissement avec jolis décors, tutus et pointes. Avec cette nouvelle entrée au répertoire d’une œuvre fondatrice du Tanz Theater cher à la chorégraphe allemande, l’Opéra de Paris nous emmène pendant près de deux heures sans entracte sur le terrain d’une danse contemporaine radicale qui explore la violence conjugale, les dynamiques de soumission et de domination dans les relations hommes-femmes et in fine le féminicide.

Créée en 1977, la pièce de Pina Bausch s’intitulait initialement En écoutant un enregistrement sur bande magnétique de l’opéra de Béla Bartók « Le Château de Barbe-Bleue ». L’unique opéra du compositeur hongrois créé en 1918 sert en effet de fond sonore à l’œuvre chorégraphique. Si, thématiquement, Pina Bausch reste proche du livret de Béla Balázs en se focalisant sur la relation vouée à l’échec entre Barbe-Bleue et sa dernière femme Judith, il ne s’agit pas d’une adaptation littérale. C’est plutôt une variation dans le contexte socio-culturel de la fin des années 70 autour du paradoxe de l’amour: comment en cherchant à atteindre la plénitude de l’amour et à ne faire qu’un, on en arrive à violer l’intimité de l’autre et à générer le conflit.
Dans la grande pièce d’une demeure abandonnée, une femme (Léonore Baulac) dans une tunique vieux rose, ses longs cheveux détachés lui servant de couche et les bras levés vers le plafond, est allongée à même le sol, jonchée de feuilles mortes. Côté cour, un homme massif vêtu d’un pardessus gris, Barbe-Bleue, Takeru Coste, a de faux airs de Marlon Brando. Il manipule un magnétophone fixé sur une table à roulette qui joue l’opéra de Béla Bartók. Il va vers sa femme, s’étend sur elle qui paraît comme morte, semble la violer puis retourne à son magnétophone pour rembobiner la bande compulsivement à plusieurs reprises ? A chaque fois, il retourne la violer. Est-ce un viol ? Est-elle consentante ? Le ton est donné, il y aura peu de raison de se réjouir dans les 2 prochaines heures. La chorégraphe jouera tout du long de la pièce sur la répétition, une répétition qui questionne le spectateur et qui donne un caractère lancinant et insupportable à la violence ordinaire de la relation entre Barbe-Bleue et sa femme.

Dans une autre scène, Léonore Baulac semble reprendre le dessus face à son colosse de mari. Un ensemble de danseuses et danseurs que l’on croirait échappés d’une farandole festive s’introduit dans la grande demeure. Judith va sélectionner des femmes au hasard dans la file, confrontant son époux aux fantômes de ses anciennes épouses. L’étoile fait preuve d’une grande force dans le rôle éprouvant de Judith, derrière son apparente fragilité. Tantôt elle le provoque, tantôt elle cherche à apaiser ses démons, se retrouvant à la merci des pulsions de Barbe-Bleue.
En contrepoint, les ensembles (10 danseurs et 10 danseuses) jouent eux aussi la chorégraphie de la guerre des sexes : masculinité triomphante des play-boys en mini shorts colorés qui font tomber les midinettes à la plage ou femmes harpies qui ne voient dans l’homme qu’un instrument pour satisfaire leur désir. Il y a de brusques éruptions de cris et de courses sur scène qui agressent le spectateur. Le regard de Pina Bausch est résolument pessimiste. Il y a beaucoup à voir sur scène, sans doute que la compréhension de l’allemand et la connaissance de l’opéra de Béla Bartók permettraient de mieux saisir toutes les nuances de l’œuvre. On comprend également ce que le travail du répertoire de Pina Bausch peut avoir de satisfaisant pour les danseurs de l’Opéra de Paris, et combien il va les marquer dans leur corps et leur cœur d’artistes. Aux côtés de Léonore Baulac et Takeru Coste, la troupe est impeccable avec les habitués du contemporain, mais aussi des danseurs qui pourraient tout à fait être sur l’autre série de l’été, Le Lac des Cygnes : je pense à Alice Catonnet, Naïs Duboscq, Francesco Mura ou encore Fabien Révillion.
Le final avec le meurtre de Judith et la profanation répétitive de sa dépouille traînée sur toute la scène par Barbe-Bleue est sans doute la scène la plus dure que j’ai pu voir dans un spectacle vivant. J’ai trouvé le spectacle dans son ensemble déplaisant sur l’instant, mais il faut bien avouer que c’est une pièce qui vient vous hanter rétrospectivement et dont certains tableaux impriment durablement la rétine.
Mots Clés : Barbe-Bleue,Léonore Baulac,Pina Bausch,Takeru Coste