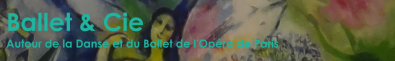C’est avec deux semaines de retard sur mon agenda initial que j’ai découvert le grand ballet des fêtes de fin d’année à l’Opéra Bastille. La sinistrose parisienne ambiante avait quelque peu entamé le plaisir que je me faisais de retrouver la luxueuse production parisienne de la Bayadère, ultime leg de Noureev à la troupe qu’il a dirigée de 1983 à 1989 et ballet testament tout court à travers lequel le chorégraphe ravive la mémoire de ses années de formation à Saint-Petersbourg.

Les décors d’Ezio Frigerio pour la Bayadère
Pourtant, il suffit d’entendre les premières mesures de la partition de Minkus et de voir le rideau se lever sur l’Inde féérique recréée avec faste par Ezio Frigerio pour oublier les militaires armés qui patrouillent sur la place de la Bastille et les mesures de sécurité renforcées à l’entrée de l’Opéra.
La Bayadère est un ballet fascinant parce que l’histoire qui répond aux conventions du genre romantique (une jeune fille chaste trahie par son amant vient le poursuivre dans ses rêves et ils se retrouvent dans un royaume fantasmagorique) est transposée dans un cadre indien inspiré par les récits romancés des voyageurs aventuriers du XIXème siècle. Solor, le courageux guerrier, est amoureux de Nikiya, la jolie danseuse et servante du temple, harcelée par le grand brahmane. Ce dernier va dénoncer les amours de Nikiya et Solor au rajah qui veut marier sa fille Gamzatti à Solor. Gamzatti tente d’acheter Nikiya pour qu’elle renonce à Solor: les deux jeunes femmes s’affrontent violemment, Nikiya menaçant avec un couteau sa rivale. Mais c’est Gamzatti qui a le dernier mot. A l’occasion de ses somptueuses fiançailles avec Solor, elle fait cacher un serpent venimeux dans une corbeille offerte à Nikiya durant la danse que celle-ci doit effectuer pour les fiancés: d’une part, la malheureuse bayadère s’aperçoit de l’inconstance de Solor, d’autre part, elle se fait mordre par le serpent et meurt. Solor ne peut se pardonner sa trahison, il sombre dans la dépression et l’opium: lors de l’un de ses rêves, il retrouve, dans le Royaume des Ombres, sa chère Nikiya qui lui pardonne.

Le royaume des Ombres
L’attention du spectateur est maintenue tout au long des trois actes: il y a un bon équilibre entre la pantomime et la danse dans le premier acte avec des personnages forts, les divertissements du deuxième acte ne font pas retomber la tension dramatique, boostés par le triomphe de Gamzatti et la mort de Nikiya, et enfin l’acte blanc, illustration de l’incomparable savoir-faire de Marius Petipa, est d’une beauté à couper le souffle.
La distribution du 3 décembre était celle de la première, réunissant deux étoiles parisiennes de stature internationale, Dorothée Gilbert et Mathias Heymann, une nouvelle première danseuse avec de grandes espérances, Hannah O’Neill, et la quasi étoile, François Alu.
Dorothée Gilbert est décidément trop rare sur les scènes parisiennes, mais cette rareté donne aussi un prix à chacune de ses apparitions: la jeune fille d’à côté, simple et charmante, est désormais une vraie prima ballerina qui allie une grand force d’interprétation à une technique sans faille. Sa danseuse sacrée, tout en raffinement avec un superbe travail des bras et du haut du corps, sait alterner tendresse dans son rendez-vous avec Solor, détermination face au brahmane et à Gamzatti, sensualité dans le pas de deux de l’Esclave (superbement soutenue par Yann Saïz) ou grâce éthérée empreinte de lyrisme dans l’acte blanc.
Mathias Heymann, s’il a la souplesse et la détente féline, reste trop “noble” dans son interprétation de Solor. Solor n’est pas le Siegfried un peu paumé de la version Noureev du Lac des Cygnes. Il peine ainsi à exister entre les deux ballerines qui se disputent ses faveurs, ce qui contribue à mettre en lumière ses difficultés dans le partenariat. Paradoxalement, c’est avec la Gamzatti d’Hannah O’Neill que l’alchimie technique se fait le mieux.

Hannah O’Neill et Mathias Heymann
Avec Dorothée Gilbert, les portés et les soutiens passent trop souvent sur le fil du rasoir pour que le duo puisse danser de façon libérée. L’émotion dans l’acte blanc passe en grande partie par le dialogue silencieux entre Nikiya et Solor: on se prend alors à regretter que Mathias Heymann ne puisse se transformer l’espace des pas de deux en Karl Paquette ou Stéphane Bullion. C’est lors des variations lentes du troisième acte, dont on pourrait jurer que Noureev les a cousues main pour lui, que l’on retrouve tout le génie de Mathias Heymann.
Hannah O’Neill, rayonnante de beauté et d’assurance, a livré une performance technique de très haut niveau, se payant même le luxe d’être plus applaudie que son partenaire dans le pas de deux des fiançailles.

François Alu, l’Idole Dorée
La Bayadère c’est aussi une multitude de seconds rôles : François Alu, extraordinaire Idole Dorée, Hugo Vigliotti qui donne de l’épaisseur au personnage de Fakir, Silvia Saint-Martin vive et inspirée dans la danse “Djampo” et la danse “Manou”. Sabrina Mallem et Fabien Révillion sont déchaînés dans une danse indienne menée tambour battant, rappelant le talent des danseurs russes dans ce genre de danses de caractère parfois fades à Paris. Les ensembles étaient parfaitement réglées avec notamment une descente des ombres envoûtante. Enfin, dans ce troisième acte, hymne à la beauté et à la poésie, on retiendra aux côtés de Marion Barbeau et de Valentine Colasante la deuxième ombre éblouissante d’Eléonore Guérineau dans une variation ciselée qui a déclenché quelques bravos spontanés.

Dorothée Gilbert et Mathias Heymann
Le corps de ballet semble en tout cas fin prêt pour offrir un écrin de choix aux danseurs invités qui vont épicer quelques unes des distributions à venir : Isaac Hernandez qui accompagnera Heloïse Bourdon les 6 et 12 décembre ou le duo du Mariinsky, Kristina Shapran et Kim Kimin les 18 et 21 décembre.
Mots Clés : Dorothée Gilbert,Eléonore Guérineau,François Alu,Hannah O'Neill,Hugo Vigliotti,La Bayadère,Mathias Heymann,Noureev,Yann Saïz